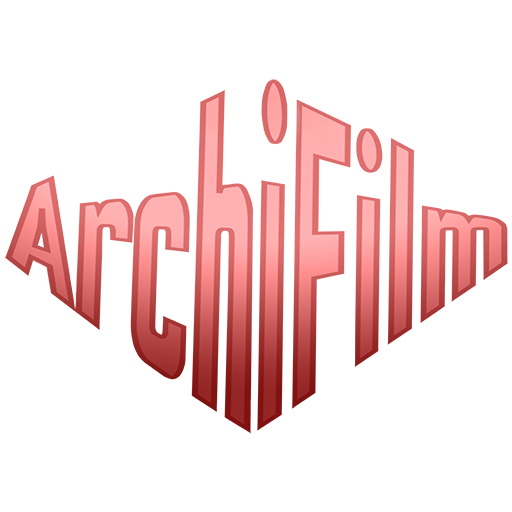2 mars 2025
Biographies d’architectes et d’architectures
La sortie cette année de plusieurs films majeurs (américains) mettant en scène des architectes, Le Brutaliste, Mégalopolis, en tête, mais aussi de films interrogeant comment vivre l’architecture, avec La Zone d’intérêt par exemple, incitent à se demander pourquoi cette thématique très spécialisée anime nos écrans. Par la nature même de son métier, l’architecte est proche du cinéaste. Il lui est nécessaire de maîtriser différents savoirs, scientifiques, culturels, historiques et managériaux. Mais sans une vision sous-jacente et artistique à ses projets, la réalisation devient mécanique, à l’esthétique corrompue par la convention et le coût de revient. Il ne s’agit pas de tirer forcément les prix vers le bas, mais d’associer la valeur des matériaux à la valeur préjugée du bâti à venir, des images à capter.

Le Brutaliste, Brady Corbet, 2025
C’est d’ailleurs ce manque d’implication morale et esthétique que reproche László Tóth, héros du film de Brady Corbet interprété par Adrien Brody, au second architecte qui lui a été imposé pour revoir ses plans et éliminer les dépenses non fonctionnelles : ce dernier n’a dessiné que des supermarchés et n’a aucune vision de ce qui est vraiment utile. A chacun ses étagères, mais les siennes aspirent à la lumière et à la culture. La hauteur de plafond est aussi une question de hauteur de point de vue. Il en va de même pour le réalisateur, et la situation de Corbet qui réalise le Brutaliste est professionnellement comparable à son personnage principal. Ce n’est pas l’argent qui doit dicter son propos. L’économie de son film a écarté son scénario d’office de la production mainstream : trop de décors, trop de récits, trop d’implicites, que les majors américaines n’ont pas pris en charge.

Megalopolis, Francis Ford Coppola, 2024
Avec Mégalopolis, Francis Ford Coppola se place lui-aussi en marge d’un cinéma bien huilé et s’écarte d’une industrie qu’il conspue, la qualifiant d’usine Mc Donald standardisant la culture par le bas, broyant dans un hachis pour adolescents tout goût différent. Il y a chez César Catalina, l’urbaniste héros, le même désir de construire un monde hérité d’un temps où les oligarques corrompus n’avaient pas le pouvoir. Son film foutraque n’est pas tant un film de science-fiction qu’une méditation actuelle sur le pouvoir économique et politique américain et sur sa vision de New York. Franklyn Cicero, le maire fictif de New Rome, n’a rien à apprendre des promoteurs politiques contemporains.

La Zone d’intérêt, Jonathan Glazer, 2024
Dans La Zone d’intérêt, Jonathan Glazer filme de façon sidérante la maison et son jardin adjacents au camp d’extermination d’Auschwitz. L’architecture est d’une banalité bourgeoise confondante, une maison sans charme avec des chambres pour chaque membre de la famille, la verrière et l’appentis, le bassin et les fleurs qui embellissent la vue. Rudolf Höss, le commandant, n’est pas architecte, il regarde les espaces et compte combien de personnes il pourrait y enfermer et comment les faire disparaître. Une froideur mortelle imprègne chaque plan, et les allusions à notre époque, où chacun s’active utilement sans état d’âme à nettoyer les murs nous interrogent sur ce que nous voyons et surtout, sur ce que nous ne voyons pas.

La Zone d’intérêt, Jonathan Glazer, 2024
Ces trois exemples pointent comment l’architecture agit sur les consciences et comment les cinéastes s’en inspirent. Une des premières mesures prises par Donald Trump est d’imposer « une belle architecture fédérale ». Le Président américain a signé dès le premier jour de son investiture un décret stipulant que « Les bâtiments publics fédéraux doivent être visuellement identifiables en tant que bâtiments civiques et respecter le patrimoine architectural régional, traditionnel et classique afin de rehausser et d’embellir les espaces publics et d’ennoblir les États-Unis ». Son aversion pour l’architecture brutaliste et du style déconstructiviste est notoire. Cette volonté de standardiser les édifices publics marque-t-elle un désir de mise au pas de l’administration ? Ces dernières actions laissent entrevoir la réponse. Les cinéastes ont compris avant son arrivée à la Maison Blanche qu’à l’instar de l’architecture qui témoigne des tensions de notre époque, ils avaient avec leur art, la possibilité de braquer la caméra sur ce qui habite notre époque. Car derrière les murs de l’indifférence qui ne cessent de se dresser, le monde ne se protège pas mais entretient les peurs, le rejet de l’autre voire sa destruction. Est-ce vraiment cela que nous voulons ?
27 décembre 2024
A l’occasion de la sortie du dernier film de Pedro Almodovar qui sort ce mois-ci sur nos écrans, La Chambre d’à côté, nous nous sommes interrogés sur la place des appartements dans les films du réalisateur madrilène.
Les appartements publics de Pedro Almodovar

Effectivement, les maisons y sont nettement moins représentées, et à regarder de près, elles sont souvent compartimentés recréant un appartement à l’intérieur d’elles-mêmes avec des zones prêtées à un(e) proche, à un individu invité, avec ou sans son consentement… Dans son cinéma, l’architecture n’est jamais un simple décor : elle joue un rôle actif en reflétant les émotions des personnages, en renforçant les thématiques narratives, et en établissant des contrastes entre tradition et modernité. À travers des maisons stylisées, des cliniques modernes, ou des rues vibrantes de Madrid, Almodóvar utilise l’architecture pour symboliser les tensions sociales, la fluidité identitaire et les relations humaines.
Les appartements qu’il filme, souvent richement décorés et hautement symboliques, servent de cadre à l’introspection, aux relations complexes et aux drames émotionnels. ChatGPT donne une liste des films où les personnages principaux habitent dans des appartements, ainsi que des exemples marquants de leur rôle narratif :
- Femmes au bord de la crise de nerfs (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988)
Pepa (Carmen Maura) vit dans un appartement lumineux mais désordonné, qui devient un véritable théâtre du chaos émotionnel.
- Talons aiguilles (Tacones lejanos, 1991)
Rebeca (Victoria Abril) vit dans un appartement moderne à Madrid, reflet de son indépendance et de son mode de vie urbain.
- Kika (1993)
Kika (Verónica Forqué) habite dans un appartement coloré et excentrique, symbolisant sa personnalité optimiste et sa vie mouvementée.
- La fleur de mon secret (La flor de mi secreto, 1995)
Leo (Marisa Paredes) vit dans un appartement sobre qui illustre sa solitude et son combat intérieur.
- Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre, 1999)
Manuela (Cecilia Roth) revient vivre dans un appartement modeste à Madrid après la mort de son fils, lieu de refuge et de reconnections.
- Parle avec elle (Hable con ella, 2002)
Benigno (Javier Cámara) vit dans un appartement organisé et stérile, reflétant sa vie structurée mais émotionnellement perturbée.
- Mauvaise éducation (La mala educación, 2004)
Ángel/Zahara (Gael García Bernal) vit dans un appartement qui sert de lieu de création et de dévoilement des secrets du passé.
- Volver (2006)
Raimunda (Penélope Cruz) vit dans un appartement modeste de banlieue, qui devient le centre de sa lutte pour protéger sa famille.
- Les amants passagers (Los amantes pasajeros, 2013)
Bien que l’histoire se passe principalement à bord d’un avion, certains flashbacks montrent des personnages dans leurs appartements respectifs, notamment celui de Ricardo.
- Douleur et gloire (Dolor y gloria, 2019)
Salvador Mallo (Antonio Banderas) vit dans un appartement spacieux et artistique, qui reflète sa vie intérieure et son passé d’artiste en quête de rédemption.
La description est sèche et non argumentée. Elle est silencieuse sur les premiers films d’Almodovar, pourtant déjà riches en décors habités. Mais elle confirme notre intuition d’y regarder de plus près. Almodóvar utilise l’appartement comme un microcosme, condensant l’intimité et les drames personnels dans un espace confiné mais hautement symbolique. Il sature l’espace de couleurs franches et contrastées. Le rouge, le jaune et le bleu dominent ses intérieurs et extérieurs, créant une palette émotionnelle unique. Les lignes droites et modernes contrastent souvent avec des formes plus organiques et chaotiques, reflétant les conflits internes des personnages. Dans ses décors, Almodóvar mélange également des influences architecturales diverses : l’Art déco, le modernisme espagnol, et même des éléments de kitsch. Cette diversité reflète la richesse culturelle de l’Espagne contemporaine, tout en soulignant l’éclectisme de son approche cinématographique.

Femmes au bord de la crise de nerfs (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988)
Le film Femmes au bord de la crise de nerfs (1988), illustre bien le traitement que réserve Almodovar aux lieux de vie. L’appartement de Pepa (Carmen Maura) transcende son rôle de simple décor pour devenir un véritable héros du film. Ce lieu excentrique et vibrant n’est pas seulement un espace physique : il agit comme un personnage à part entière, catalyseur des événements, révélateur des émotions des personnages, et miroir des thématiques centrales de l’œuvre. L’appartement joue ce rôle héroïque en condensant l’espace, faisant éclater la sphère du privé dans le chaos d’un Madrid post franquisme. Il est le principal lieu de l’histoire, où les personnages se croisent, où les secrets éclatent, et les conflits se dénouent. Il agit comme une scène de théâtre, concentrant toute la tension dramatique dans un lieu unique. Cette concentration diégétique, les événements qui s’y déroulent – l’arrivée impromptue des visiteurs, les quiproquos, et les révélations – renforcent le caractère burlesque et frénétique du film.

Femmes au bord de la crise de nerfs (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988)
La décoration de l’appartement et son aménagement agissent en miroir, ils renvoient davantage au portrait chinois de l’héroïne, plutôt qu’à un lieu habitable. D’ailleurs, ne s’acharne-t-elle pas à détruire ce qui pourrait lui être utile pour y vivre ? Elle met le feu au lit, casse son téléphone, empoisonne son frigidaire… L’appartement reflète l’état émotionnel de Pepa. Les couleurs vives, notamment le rouge omniprésent, traduisent la passion, la colère et la confusion qui animent le personnage. Ce lieu devient une métaphore visuelle de son chaos intérieur, exacerbant son désarroi face à la rupture amoureuse. Les objets, les plantes dans l’appartement semblent être tous chargés d’une intention tant ils servent de leviers émotionnels ! Rien n’est là pour faire décor, mais chaque chose pourrait s’imposer au premier plan tant ils sont ancrés dans le récit.
On retrouve le regard aiguisé de Pedro Almodovar sur l’architecture dans Tout sur ma mère (1999). L’appartement de Manuela (Cecilia Roth) joue un rôle essentiel dans la narration et transcende sa fonction de simple décor pour devenir un élément narratif puissant. À travers cet espace, le réalisateur explore les thèmes de la perte, de la résilience et de la reconstruction émotionnelle.

Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre, 1999)
Après la mort tragique de son fils Esteban, son logement devient un espace de deuil. Les objets laissés par Esteban, comme son carnet de notes ou ses vêtements, remplissent le lieu d’un silence éloquent, symbolisant la présence persistante de l’absent. Cet espace agit comme une mémoire matérielle, un lieu où Manuela confronte son chagrin et cherche à comprendre son propre rôle dans la perte de son fils. Ce premier appartement représente un refuge pour Manuela, un lieu de sécurité où elle peut s’effondrer loin des regards du monde extérieur. Cependant, il devient également le point de départ de son voyage émotionnel. Lorsqu’elle quitte cet appartement pour retourner à Barcelone, elle abandonne cet espace initial, marquant le début de son processus de reconstruction et d’autonomisation.

Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre, 1999)
En arrivant à Barcelone, Manuela s’installe à une nouvelle adresse. Ce nouvel appartement symbolise une étape intermédiaire, où elle commence à reconstruire sa vie tout en tissant des liens avec d’autres personnages (Agrado, Rosa, Huma). Le nouvel appartement de Manuela devient un espace de soin et de solidarité. C’est ici qu’elle offre un foyer à Rosa (Penélope Cruz) et qu’elle prend soin d’elle pendant sa grossesse, transformant ce lieu en un sanctuaire d’amour et de guérison. Ce logement, d’abord marqué par l’absence, devient un endroit où des relations se tissent, où des vies s’entrecroisent et où le passé se confronte au présent. Petit à petit, par sa décoration, l’appartement évolue : les objets personnels de Rosa ou les souvenirs d’Agrado se mêlent à ceux de Manuela, symbolisant une communauté qui s’est formée dans la douleur mais aussi dans l’espoir.
Dans Tout sur ma mère, l’appartement de Manuela, puis celui qu’elle occupe à Barcelone, ne sont pas de simples cadres. Ils sont des acteurs silencieux mais puissants du récit, témoins de la douleur et de la résilience des personnages. Par leur capacité à refléter les thèmes de la perte, de l’amour, et de la reconstruction, ces espaces deviennent des héros du film, incarnant à la fois le poids du passé et les possibilités d’un avenir nouveau. Dans ce film, comme dans d’autres œuvres d’Almodóvar, l’appartement est un miroir des émotions des personnages. À travers les objets qui s’y trouvent, les interactions qui s’y déroulent et les transformations de l’espace, Almodóvar donne vie à une architecture émotionnelle qui parle autant que les dialogues. L’appartement devient un lieu d’introspection, mais aussi un espace de transformation pour les autres personnages qui y entrent.
Dès lors, le logement privé bouscule l’attente du refuge personnel, et devient une interface avec le monde et les espaces publics. Cette porosité reflète l’intérêt de l’artiste pour l’interpénétration des sphères intimes et sociales, souvent dans un contexte d’exploration des identités, des désirs et des normes culturelles. Dans Femmes au bord de la crise de nerfs, la terrasse et le penthouse de Pepa, quoique privés, deviennent un lieu d’interaction collective où les intrigues personnelles éclatent en pleine lumière. Cette abolition des frontières entre privé et public est accentuée par les choix visuels et narratifs du réalisateur : les fenêtres, les portes ouvertes, les balcons ou encore les miroirs servent de métaphores visuelles pour montrer comment les sphères privée et publique se reflètent et s’influencent mutuellement. Dans Parle avec elle (2002), les espaces hospitaliers, censés être publics et aseptisés, deviennent des lieux de confidences et d’éveil émotionnel par exemple.

Parle avec elle (Hable con ella, 2002)
L’appartement de Benigno, le héros du film est un espace profondément intime, marqué par son isolement social et son obsession pour Alicia. Cet espace, décoré avec soin, est rempli d’éléments qui reflètent son monde intérieur : les photographies d’Alicia, les objets qu’il collectionne en lien avec elle, et un ordre méticuleux. Pedro Almodóvar construit un contraste et un dialogue subtil entre le logement de Benigno et les lieux publics, notamment l’hôpital où il travaille. L’appartement est un lieu de protection, mais aussi de cloisonnement. La propreté et l’organisation y soulignent une tentative de contrôle sur sa propre vie, et par extension, sur celle d’Alicia. Ce sanctuaire devient toutefois un espace d’ambiguïté morale, où la frontière entre soin et obsession est franchie. L’intime est ici poussé à l’extrême, à tel point qu’il devient envahissant, voire dérangeant.
En contraste, les lieux publics – principalement l’hôpital – sont des espaces fonctionnels où les interactions entre individus sont codifiées et distantes. C’est un espace de soin impersonnel où les normes professionnelles imposent une barrière entre le personnel médical et les patients. Cependant, Benigno parvient à « privatiser » cet espace public par son comportement. Il investit l’hôpital d’une dimension intime et transgresse ses règles, en transformant ses soins à Alicia en une interaction profondément personnelle. Sa manière de lui parler, de lui raconter des histoires, et de s’imaginer un lien émotionnel mutuel brouille la limite entre le rôle professionnel et le lien privé qu’il désire instaurer. Les échos entre l’appartement et l’hôpital envahissent l’écran. Les deux espaces se rejoignent dans leur fonction de contrôle sur Alicia. L’appartement est un espace où Benigno exerce un contrôle symbolique en cultivant son obsession, tandis que l’hôpital devient le lieu où ce contrôle devient physique, dans ses soins quotidiens et ses interactions avec son corps inerte. Les deux lieux partagent également une atmosphère de silence et d’immobilité : l’absence de dialogue réel avec Alicia dans l’appartement ou à l’hôpital souligne la solitude de Benigno et sa quête d’un lien impossible.

Parle avec elle (Hable con ella, 2002)
Ce parallèle met en lumière des thématiques centrales du film, telles que l’intimité, le contrôle et l’ambiguïté morale. Ce brouillage de l’intimité reflète également le contexte socio-culturel post-franquiste de l’Espagne. Les films d’Almodóvar ont capturé une époque où les normes de la vie privée et publique étaient en pleine mutation, notamment en ce qui concerne le genre, la sexualité et la famille. Ces trois œuvres exemplaires, mais nous aurions pu en choisir d’autres, reflètent une dynamique propre à Almodóvar : les émotions privées débordent souvent des cadres sociaux ou des espaces définis, brouillant les conventions et mettant en lumière les contradictions humaines.
Notre époque marque un retour majoritaire aux valeurs familiales traditionnelles, même si leur interrogation, voire contestation, est vive. Pedro Almodovar a assagi sa mise scène baroquisante de ses débuts. Mais il continue, via sa façon de filmer l’architecture, de plus en plus littérale, jusqu’à en donner le titre à sa dernière œuvre, La Chambre d’à côté, d’exposer ce qui au plus profond de nous-mêmes nous bouleverse et fait tomber nos certitudes.
17 septembre 2024
A l’occasion de la sortie d’Anora, le film de Sean Baker primé à Cannes, ces premiers films ressortent.
Sean Baker : la norme désintégrée

Sean Baker n’est plus un inconnu et sa récente palme à Cannes, Anora, devrait attirer un public qui n’a pas encore croisé sa route. Car le bonhomme a pu décourager ou attirer le public à cause d’un fonds d’histoires à priori racoleuses, entre prostitués, acteurs porno et marginaux drogués entre autres, alors que son regard vise bien autre chose. Ce malentendu, ou plutôt mal vu, devient de plus en plus manifeste quand on s’arrête non plus sur les personnages hauts en couleur qu’il décrit, mais sur les lieux où ils vivent.
Et là, l’immensité de l’Amérique et la démesure de ses villes et banlieues brillent de lumières trop vives, saturées, pour des héros dont la chrysalide fragile se déchire, à l’instar de papillons qui ne pourront s’envoler, captés, fascinés. Les images de Baker ont un grain particulier, un grain de déjà-vu, avec des couleurs issues de la publicité, des cadrages au grand angulaire laissant beaucoup de profondeur de champ, de zones trop nettes, trop étendues, qui révèlent le vide dont elles sont faites. Il n’hésite pas d’ailleurs a utilisé un iPhone pour enregistrer les aventures de deux Queens transsexuelles dans Tangerine (2015). Ce choix n’est pas innocent. La caméra du smartphone est dopée à l’intelligence artificielle, elle triche par sa colorimétrie flatteuse et les filtres qui uniformisent la perception de ce qui est cadré, rectifiant automatiquement les bougés, fluidifiant les mouvements… Baker s’était auparavant servi d’une caméra 35 mm, obsolète aujourd’hui dans notre monde numérique, pour réaliser Starlet, en 2012. Il filmait alors les relations amicales d’une jeune femme et d’un octogénaire. La qualité visuelle renvoyait à une nostalgie cinématographique du siècle dernier, époque révolue de la personne âgée. Bref, le réalisateur s’arme d’outils pour capter non pas ce qu’il regarde, mais ce que les industries technologique et médiatique attendent de voir et veulent montrer.

Or, filmer des exclus et des communautés minoritaires de la société avec cette approche marquée d’air du temps majoritaire, c’est-à-dire ce clinquant hypertrophié au montage rapide, c’est se confronter au danger d’une esthétique post pop-art archi rebattue jusqu’à l’écœurement (le monde il est beau et joyeux, voyez mes couleurs !), d’une esthétique commerciale dénuée d’éthique, où les corps sont filmés comme des objets consommables et d’un kitsch qui brandit son mauvais goût comme étendard violent contre les « bonnes » mœurs contemporaines (du moins, celles qui dominent !). C’est là que l’architecture va jouer son rôle de catalyseur. Le réalisateur inscrit ses personnages non pas dans un monde exotique, extraordinaire, exagérément beau ou désespéramment étouffant, non, il les fait évoluer au sein d’un monde quotidien, avec ses architectures vernaculaires que l’on voit partout dans les blocs de New York, telles les boutiques et arrière-salles du Prince de Broadway en 2008 ; le long des périphériques bordés par les motels anonymes du Florida Project en 2017 ; les restaurants et boulangeries d’une bourgade perdue texane dans Red Rocket en 2021, etc.

Comment dans ces lieux bâtis pour être occupés par tous peut-on être alors dedans et exclu(e) à la fois ? La forme ouvrait déjà des pistes, par son parti pris d’artificialisation du réel. Le réel n’est pas à sa place dans la vie des protagonistes. C’est une construction mentale qui ne tient pas debout. Tout est tristement sans vie, répétitif. Les chambres sont interchangeables, c’est d’ailleurs une spécificité du motel qui accueille une population dans le besoin dans Florida Project. A partir d’un certain nombre de nuitées, il est obligatoire de changer de pièce. On prend ses affaires, on change de clés et on s’installe quelques mètres plus loin. Ainsi, la personne ne se domicile nulle part officiellement, même si géographiquement, elle est assignée à rester dans cette zone dévolue à l’automobile. Les enfants désœuvrés ne connaissent pas les règles implicites et la propriété privée est une notion bien inutile pour eux. Au sein de la pension, ils vont de chambre en chambre, s’approprient la coursive, franchissent les palissades et errent dans des lotissements abandonnés suite à la crise immobilière.

Quand on ne parvient pas à s’insérer socialement, avoir un chez soi devient une gageure. Il y a toujours un abri, un lieu de départ et de retour, où on espère pouvoir se ressourcer, mais dans les faits, les héros de Baker déambulent dans la rue les points fermés, la peur au ventre. Le Prince de Broadway conte l’histoire d’un jeune noir sans-papiers qui vit dans un quartier populaire et trafique des vêtements et sacs de contrefaçon pour subvenir à ses besoins. Sa chambre est petite, mais pas misérable. La salle de bains est à l’étage. Le propriétaire vit dans la maison, on ne le voit pas et ne joue aucun rôle déterminant pour l’histoire. Bref, c’est un endroit sans pathos exagéré. Mais on sait que le jeune homme clandestin est obligé d’être très silencieux et ne peut inviter personne sous peine d’être mis à la porte. Dès lors, sa vie et ses relations se construisent dans la rue et le bloc. Il faut discuter et convaincre les passants d’entrer dans une échoppe pour faire des affaires. Et là, les murs se rétrécissent encore davantage. Cachée derrière des habits suspendus au mur du fond, une porte dérobée s’ouvre sur une mini grotte d’Ali Baba, où le consommateur peu scrupuleux peut trouver baskets, sacs et articles de mode de toutes marques. Pour lancer son affaire, travailler à son compte, le héros vend aussi à la sauvette, avec juste le coffre de la camionnette comme stock et espace de vente. Partout autour du protagoniste, les vitrines offrent une vue dégagée, mais lui perçoit le monde rabougri de toutes parts.

La grande ville et la périphérie ne sont pas des terres d’accueil, c’est entendu. Mais alors, quid de la campagne ? Bah, à peu de choses près, il vaut mieux y avoir de solides raisons pour y retourner ! Red Rocket est explicite, et bien plus dur et violent que Broadway d’ailleurs ! Le rêve de la maison individuelle est un gâchis architectural, avec des logements pitoyables dans leurs matériaux de fabrication, leur entretien défaillant, leur uniformité standardisée. A l’image des espoirs de ses habitants, pour qui le porno et la drogue sont des dérivatifs inavouables. Quand Mikey Saber, ancienne star du X revient dans sa ville natale, sa seule chance de survie sera la rencontre avec une mineure passionnée de sexe. Et pas pour rester dans le fastfood de donuts où elle travaille, lieu déclinable à l’envie partout, mais en quittant cette cité irrémédiablement copiée/collée, à atmosphère velléitaire et poisseuse et en s’enfuyant vers le rêve californien… Dont a compris qu’il avait également déçu le héros dès le début du film.

L’architecture dans la filmographie de Sean Baker a joué un rôle de marqueur social, mais, jusqu’à Anora, elle s’était contentée de se confronter aux classes pauvres et/ou exclues américaines. Avec son nouveau film, il aborde une fois de plus les marges, mais s’intéresse cette fois-ci aux riches et leurs habitus. Qu’est-ce que les villas privées, les lieux de fête peuvent-ils avoir à nous raconter maintenant, sur notre époque ? Y a-t-il une échappatoire à la misère psychique, là où la richesse du cœur est une valeur précieuse ?

2 Août 2024
La rentrée va nous offrir son lot de sorties et d’évènements à ne pas manquer. La rétrospective au Centre Pompidou consacrée à Frederick Wiseman nous fait déjà saliver.
Frederick Wiseman : franchir les murs intérieurs ?

Frederick Wiseman en montage
Frederick Wiseman est connu pour son regard porté sur les personnes au sein des institutions, hôpital, prison, école, bibliothèque, armée, théâtre, mode, etc. Souvent l’analyse de son œuvre s’axe sur l’humanisme silencieux de l’artiste. En montrant comment chacun (ré)agit au milieu des contraintes sociales, légales, culturelles et historiques, il offre un portrait perçant du monde américain et occidental qui nous renvoie à notre besoin de services publics respectueux et respectés et de notre usage des institutions. Mais à la différence d’un Michael Moore dont l’engagement s’affirme au fil des plans par un discours militant et argumenté, Wiseman, lui, s’éclipse de l’image et du son. Il préfère poser sa caméra et filmer, filmer, filmer, et enregistrer les sons – ce qu’il fait d’ailleurs lui-même seul, désignant de la sorte son approche empathique attachée à l’écoute, plus que la volonté de discourir.
Il en résulte une démarche finalement très peu centrée sur des individualités, personnalités exceptionnelles, mais une démarche décidément avide de découvrir des individus exemplaires, fréquentant par choix ou par obligation les lieux explorés par Wiseman. Les personnes filmées sont autant habitantes qu’habitées par l’institution dont les missions sont alors questionnées dans leur mise en œuvre, volontariste ou empêchée, positive ou négative… Au-delà donc des portraits, les documentaires du cinéaste montrent aussi comment un lieu façonne notre vie. D’ailleurs, Wiseman ne commence pas directement ses films au contact de ses interlocuteurs, interlocutrices. Avant de plonger avec sa caméra dans leur quotidien, il prend le temps de dévoiler à travers des plans généraux, souvent fixes, la construction de l’espace où se situe l’action. Cela est d’autant plus important, que parfois, l’action sera refermée sur un unique lieu, comme dans Titicut Follies (1967), un hôpital psychiatrique pénitentiaire, ou éclatée, comme dans Ex Libris : New York Public Library (2017), dont les multiples antennes et services sont disséminés dans la ville.

Titicut Follies (1967)
Dans le premier cas, le film s’ouvre sur un plan de scène sans décor, seuls les visages sont éclairés sans qu’on puisse identifier le lieu, ni le statut des chanteurs, où se côtoient malades incarcérés et surveillants. Il n’y a plus qu’un groupe mimant (grossièrement) la joie de vivre, sans perspective pour s’en sortir.

Ex Libris : New York Public Library (2017)
Dans le deuxième exemple, une enseigne défraichie indique la bibliothèque new yorkaise. Puis un plan présente l’entrée du bâtiment principal construit dans le style beaux-arts américain, ultra référencé et académique dans ses citations antiquisantes, et enfin, nous pénétrons le lieu. Mais au lieu de voir directement ce qu’il s’y passe, Wiseman a pris déjà un peu d’avance et filme de dos un orateur qui s’adresse à une foule compacte et bigarrée. Nous sommes perdus au cœur d’un savoir dont la transmission est ininterrompue et collective.

High School (1968)
Alors, comment passer d’une personne à une autre sans faire un marabout de ficelle ? C’est là toute l’importance de savoir ancrer le témoignage. Wiseman après ses plans d’introduction approche la caméra des protagonistes, resserrant le cadre, instituant une proximité avec le spectateur plongé à son tour au milieu des évènements. Pour changer d’endroit sans se perdre, télescoper des plans rapprochés nous ferait perdre notre attention dans un flottement du point de vue. Wiseman utilise parfois comme beaucoup de réalisateurs des fondus au noir, mais surtout, il opte pour une disjonction visuelle entre les plans, opposant intérieur et extérieur, encombrement et vide des espaces ou bien échos d’éléments architecturaux différenciés, telles les fenêtres, semblables dans leur fonctions mais très éloignées dans leur esthétique. Dans High School (1968), après avoir filmé un quartier populaire de Philadelphie vu d’une route démesurée et pas du tout pittoresque, traversant une zone commerciale et industrielle apathique, il enchaîne sur les allées et venues des enseignants et des élèves, beaucoup plus dynamiques, qui se pressent dans leur lycée. On assiste à des cours magistraux où les élèves sont alignés, puis suivent des cours de musique où les adolescents répètent regroupés dans une salle suffisamment grande pour recevoir un public inexistant, puis des élèves, pris séparément ou à deux, sont amenés dans des bureaux confinés et ainsi de suite. Toutes ces ambiances se complètent et finissent par renvoyer une image globale de ce qu’il se passe dans l’établissement. Ce n’est plus une succession de témoignages, mais une orchestration de situations distinctes qui coexistent en un lieu unique, et qui en dessine ses contours émotionnels et politiques polysémiques.

Menus-Plaisirs, les Troisgros, 2023, ainsi que les images suivantes
Aussi, lorsqu’il décide en 2023 de filmer Menus-Plaisirs, les Troisgros, ce n’est pas vraiment le souci biographique, voire hagiographique, qui motive le cinéaste. Le chef Michel Troisgros est bien entendu la figure centrale qui permet de financer le film et sa couverture médiatique. Mais une fois encore, le documentaire commence par autre chose. L’architecture va élargir les intentions initiales. Le documentaire commence par un plan de la gare de Roanne, où se trouve le fief de la famille des restaurateurs, puis suit une séquence du marché sur la place municipale, où les fils s’approvisionnent.

Les images montrent différents visages et beaucoup d’étalages, aux produits courants mais aussi exceptionnellement exotiques. Nulle envie de montrer du sensationnel, mais plutôt l’idée qu’il faut choisir ses éléments de base avec soin. Wiseman a lui aussi fait sa moisson d’enregistrements introductifs, il se rend alors dans un hôtel restaurant où le père Troisgros et ses fils s’entretiennent, autour d’une table à manger dans la salle encore fermée, de l’équilibre d’une recette à peaufiner. Puis la caméra s’intéresse à ce qui se passe dans les cuisines du restaurant Bois sans Feuilles, où les petites mains gèrent en autonomie les repas à venir. Ce démarrage est emblématique. Les Troisgros ne font rien sans le monde qui les entoure. Le restaurant n’est pas non plus un lieu fermé sur lui-même. Ce qui développe la créativité des chefs n’est pas un monde à soi, mais les échanges avec l’extérieur et le territoire.

Les rencontres avec les fermiers, viticulteurs, affineurs de fromages le rappellent de façon récurrente : c’est le sol qui nourrit les hommes et leurs inspirations. Très vite, la question du restaurant est abordée par petites touches, d’abord par des détails décoratifs, comme les baies vitrées, le parquet déstructuré, aux lattes pas tout le temps alignées et parallèles, l’agencement des cuisines et de la salle, ainsi que les allers-retours de Michel Troisgros entre ces deux espaces contigus. Les murs n’ont pas de raison d’être, il faut décloisonner la curiosité en regardant plus loin, où nos pas peuvent nous mener tant que le sol ne se dérobe pas. Puis dans les propos des uns et des autres, ce qui n’était qu’une toile de fond, une maison achetée dans les années 2010 pour la famille et permettre aux enfants d’avoir un capital de base comme le rappelle Michel Troisgros qui pense que le temps s’écoule bien vite, l’achat de la maison donc, transformée pendant deux ans afin d’accueillir du monde, est devenu une affirmation de l’identité propre de Michel Troisgros et de sa femme, enfin débarrassés de l’héritage du père, du grand-père et de l’oncle qui ont œuvré avant eux à Roanne, à la même adresse près d’un siècle durant. Bien avant cette confession du restaurateur, son épouse avait elle-même expliqué à des clients que la décoration qu’ils appréciaient venait d’ici, de là, de brocantes ou d’antiquaires huppés, bien qu’à New York, elle n’y ait rien déniché malgré les conseils qu’on lui avait prodigués. Elle prenait à cœur de choisir ce qui allait habiller la Maison, afin que les visiteurs se sentent invités et non pas utilisateurs de chambres décorées anonymement.

Le spectateur est bien sûr peu naïf, il voit bien comment cet hôtel restaurant s’inscrit dans une culture bourgeoise, où l’argent circule en abondance sans que personne n’évoque le sujet frontalement. A part deux allusions, sur le prix des bouteilles des fournisseurs coûtant plusieurs milliers d’euros, ce qui fait sourciller quand même Michel Troisgros, et la réponse d’un client au serveur qui lui demande s’il a une allergie et qui dit qu’à part l’addition, il supporte tout, on voit bien que le film s’affranchit d’une réalité financière qui n’a pas sa place dans ce milieu de la haute gastronomie. L’architecture, remaniée par Patrick Bouchain, en devient un reflet violent, à l’instar de sa structure fragmentée. En bas, la salle s’inscrit dans les poncifs de l’architecture moderne et de la Glass House de Philip Johnson, large verrue-véranda sans cloisons, dégageant la vue sur des jardins boisés et des cultures maraichères. Le manoir italianisant accolé déploie ses ailes de façon ramassée, avec des décrochages aux hauteurs anarchiques, mélangeant les tours aux fenêtres renaissance à meneaux en pierres, vitraux en ogive moyen-âgeux, surélévations, arcades, extension à la symétrie post palladienne. Ici, le style, c’est l’expansion à tout prix, c’est la somme des ingrédients divergents qui assument leur osmose improbable, tout comme les ingrédients mariés par le chef dans sa cuisine.

Regarder les films de Frederick Wiseman revient donc à déchiffrer aussi les lieux qui synthétisent et révèlent l’essence des hommes et des femmes qui font tourner les institutions dans lesquelles le cinéaste s’arrête. Le Centre Pompidou à Beaubourg propose à partir du 9 septembre une rétrospective Frederick Wiseman, nos humanités. Elle se déroulera en deux temps : chapitre 1 à l’automne 2024, chapitre 2 à l’hiver 2025. Certaines projections auront lieu en la présence de Wiseman lui-même et de nombreux, nombreuses invité(e)s. Ce sera l’occasion de voir et/ou revoir son œuvre et d’approfondir sa lecture, maintenant que la nouveauté de son style sans commentaires, la durée remarquable de ses réalisations ne focalisent plus tant nos approches critiques. Derrière l’élégance de son écriture par le montage et l’écoute de la parole des uns et des autres, nous percevons comment les lieux façonnent leurs occupants, qu’ils en soient conscients ou pas. Depuis ses premiers films de la fin des années soixante, la patine du temps a égalisé les éclats trop vifs liés à l’esprit du temps d’alors ; il reste les aspérités des espoirs entravés, la douceur des désirs triomphants, la dureté des constats immuables et la lumière des aspirations qui ne fléchissent pas.